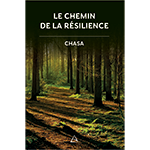Il y a aussi eu cette époque, où j’ai organisé un voyage de deux ans en Europe.
Toute ma vie avait été déplacée en conséquence. J’avais quitté mon métier peu payant pour aller faire des pourboires dans un café du centre-ville, mon appartement avait été sous-loué afin que je rapatrie toutes mes affaires personnelles chez ma mère – incluant mes deux chats –, je payais mensuellement un cubicule pour y entreposer mes meubles, j’avais quitté mon amoureux huit mois avant le départ et décrété vouloir rester célibataire afin de ne pas me distraire de mon but.
J’avais acheté un billet d’avion aller-simple, un itinéraire à travers huit pays avait été conçu avec minutie, plusieurs escales étaient prévues à travers mes contacts prêts à m’héberger, j’avais fait toutes les démarches pour obtenir un visa de travail au Royaume-Uni. Certaine de rester en Europe pendant plusieurs mois, tout mon argent avait été changé en Euros malgré un taux de change affolant.
Mais voilà. L’angoisse peut être dévastatrice, surtout quand on n’a pas conscience de sa présence.
Elle m’a accueillie dans le couloir beige menant à l’avion. Elle s’est assise sur mon siège, s’est allongée dans le hublot. Elle s’est ensuite infiltrée à l’intérieur de moi et n’a plus bougé.
Les gens dans l’avion étaient gentils. Le couple assis près de moi était distrayant et attentionné. Quand l’homme a su que j’avais une réservation à l’auberge de jeunesse de Clichy à Paris, tout en ne connaissant pas encore son emplacement exact, il a demandé d’une voix forte autour de nous si quelqu’un possédait cette information. Ils voulaient m’aider, savaient que j’étais attaquée par des nausées m’empêchant de manger ou de sourire et trouvaient regrettables que l’avion me fasse cet effet. Croyaient-ils.
Ce n’était pas le mal du transport. Ce n’était pas la première fois que je prenais l’avion et je savais que ce qui m’attaquait était bien plus démesuré que la nausée des airs. Mon cœur battait à une vitesse folle. J’étais en panique totale et je travaillais fort pour la contenir. Un avion est sûrement l’un des pires endroits où laisser exploser sa folie.
Dès que j’ai mis le pied dans le couloir beige pour rejoindre l’avion, j’ai eu la sensation que je ne reverrais jamais le Québec. C’était une certitude si forte que j’ai immédiatement voulu faire demi-tour. Elle ne m’a pas quitté de tout le périple.
Même l’action de ma bonne étoile n’a rien changé. On m’a pourtant tout offert pour m’aider et la plus grande aide est arrivée dans les toilettes de l’aéroport d’Orly. Je me débattais avec mon sac ridiculement trop grand quand une jeune fille s’est approchée de moi.
Elle s’appelait Audrey, était québécoise, avait trois ans de moins que moi et des oreilles attentives. Elle avait entendu mon voisin de siège parler de l’auberge de jeunesse de Clichy et se rendait elle aussi à cet établissement. Elle avait réservé trois nuits, tout comme moi, et nous avons réussi à obtenir une chambre de trois lits seulement. Je ne pourrai jamais l’oublier pour l’aide que sa simple présence m’a apportée, mais également pour le moment où elle a réussi à me faire pleurer de rire alors que je me sentais si mal.
Nous partagions notre chambre avec une jeune brésilienne de dix-huit ans. Passionnée et téméraire, elle était coincée depuis deux semaines à Paris parce que l’Angleterre ne voulait pas la laisser entrer sans visa. Son but? Retrouver son copain britannique – relation à distance exagérée, donc – qui avait rompu avec elle au début du mois. Résolue à le récupérer, elle avait quitté Rio de Janeiro par le premier vol en direction de l’Europe. Elle n’avait pas le visa nécessaire et tournait en rond dans Paris en ne parlant que portugais et légèrement anglais. Un traducteur internet fut parfois nécessaire pour comprendre ce qu’elle nous disait. Malgré tout, en attendant de trouver une meilleure solution, elle déambulait avec nous à travers les monuments historiques de Paris, elle qui n’avait fait aucun tourisme jusqu’ici, en-dehors de l’aéroport.
L’été en France, le soleil peut facilement attendre vingt-trois heures avant de commencer à décliner, surtout à la fin du mois de juin. Avec le décalage, la première nuit fut difficile à trouver au milieu de cette clarté, les volets ne recouvrant pas la surface complète de la fenêtre – qui elle, offrait une très jolie vue sur la Basilique du Sacré-Coeur. Exténuées, ni l’une ni l’autre n’avions dormi dans l’avion et nous étions tombées sur nos lits à dix-sept heures.
Vers vingt-deux heures, je suis réveillée par des fous rires. Mes cochambreuses sont pliées en deux dans la pièce. Audrey me raconte qu’elle s’est réveillée il y a trente minutes et qu’elle avait faim. Elle s’est donc dirigée avec notre comparse à la cafétéria pour se retrouver devant une porte fermée. Furieuse, elle est descendue à la réception pour se plaindre.
– Vous êtes censés servir le petit-déjeuner jusqu’à dix heures et il est seulement neuf heures trente!
– Mais… Mademoiselle… il est neuf heures trente du soir!
La clarté à l’extérieur était si forte qu’elle avait cru avoir dormi toute la nuit. Il lui avait suffi de lire neuf heures trente sur le cadran pour en conclure qu’il était l’heure de se lever. Notre brésilienne, qui ne pouvait communiquer avec aisance, l’avait suivie docilement sans comprendre les intentions d’Audrey et n’avait cessé de rire depuis que celle-ci lui avait expliqué gestuellement sa méprise. J’en ai ri aux larmes et nous avons partagé les fruits qu’il me restait dans mon sac. Cette petite québécoise de Portneuf était un ange rempli de rire et de jovialité et visiter Paris avec elle fut une expérience très agréable.
Malheureusement, tout ce temps, je cohabitais avec l’angoisse, qui me torturait, m’annonçait mille mauvais présages, m’accablait d’une nausée anxieuse permanente. Si j’avais cru au début qu’elle se dissiperait à l’arrivée, j’ai vite réalisé que cela ne changeait rien, sauf peut-être d’augmenter mon malaise. Elle ne lâchait pas prise et m’empêchait de manger, de sourire et de profiter du moment. Elle est visible sur toutes mes photos de ce voyage de deux ans qui n’a finalement duré que cinq jours.
J’ai appelé tout le monde. « Qu’est-ce que je fais? Qu’est-ce que je fais? ». Toi seule peux décider. C’est ce qu’ils me répondaient tous, mais ils m’assuraient que, dans tous les cas, revenir n’était pas une mauvaise chose si c’était ce dont j’avais besoin. Pourtant, c’est la première fois dans ma vie où j’ai véritablement ressenti l’échec. Où je me suis donnée un défi que je n’ai pas réussi.
Si j’avais pris conscience qu’il s’agissait d’angoisse, si à ce moment-là, j’avais déjà connu son existence et compris son mécanisme comme c’est le cas aujourd’hui, j’aurais été plus armée, moins inquiète. J’aurais su que tout cela était dans ma tête, je l’aurais combattue et je serais restée probablement bien plus longtemps.
J’avais une telle conviction de mourir pendant ce voyage et de ne jamais revoir mes proches. J’ai ressenti cela comme une faiblesse. Je n’ai pas suffisamment d’indépendance, de confiance, d’assurance, de force, de courage, de persévérance et tout autre synonyme signifiant ma lâcheté, ma petitesse en tant qu’humaine.
J’ai acheté mon billet de retour, dit aurevoir à Audrey qui poursuivait sa tournée de trois mois en France, souhaité bonne chance à cette brésilienne désespérée, qui j’en suis persuadée, n’a sûrement jamais réussi à entrer en Angleterre, et je me suis installée dans l’avion de retour. Il y avait des turbulences et chaque poche d’air me semblait le moment fatidique annoncé par mon angoisse de départ. J’allais mourir ici, au-dessus de l’Atlantique, au-dessus de l’Islande, au-dessus du Groenland, au-dessus de Terre-Neuve, au-dessus de la Gaspésie, au-dessus de la maison de ma mère.
Évidemment, rien n’est arrivé. Le danger n’a jamais été ailleurs qu’à l’intérieur de ma tête.
J’ai mis le pied au sol et l’angoisse est restée dans l’avion. Le poids s’est allégé et j’ai retrouvé la maîtrise de moi-même. J’ai fait comme si j’avais réussi, j’ai agi comme tout québécois revenant au Québec après des mois d’absence. J’ai eu envie d’une poutine.
©Alice Lepage, 2020.